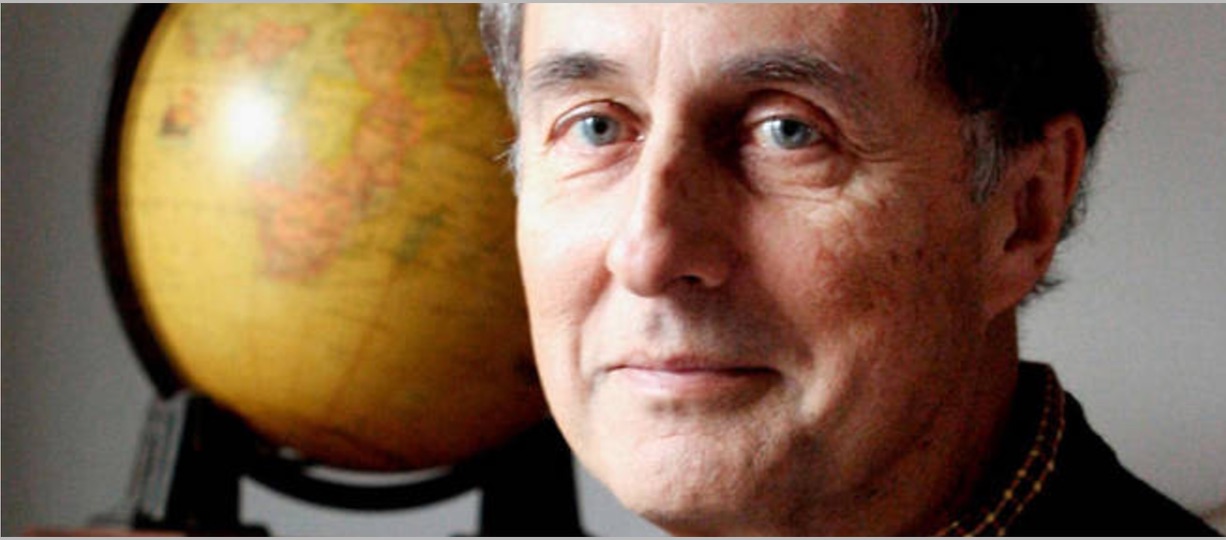
26 mai 2017 #TCHAD #France #Afrique: Serge Michailof – « L’aide française au Sahel n’est que du saupoudrage ».
Entretien. Pour ce chercheur de l’Iris, l’heure est grave. Plus que jamais, l’aide au Sahel doit être repensée et réorientée. Il explique.
Olivier Lafourcade et Serge Michailof sont d’anciens responsables de la Banque mondiale. Leur regard sur l’approche que la France a de l’Afrique est très critique. Pour preuve, ils estiment par exemple que, sur le plan militaire, la force française Barkhane se contente de « gérer des départs de feu » au nord du Mali, et, sur le plan de la coopération, que la politique française d’aide au développement s’est « fourvoyée ».
Aujourd’hui, Olivier Lafourcade est président du groupe Investisseurs et Partenaires (IPDEV), et Serge Michailof, chercheur associé à l’Iris (Institut de relations internationales et stratégiques), consultant international, a publié récemment Africanistan*, un livre qui en dit long sur les risques qu’il a identifié à propos de l’Afrique. Ensemble, les deux ont repris leurs bâtons de pèlerins durant la campagne présidentielle pour rendre compte, auprès de certains candidats, de l’incohérence des politiques d’aide au Sahel.
Passés tous deux par la Banque mondiale et par l’Agence française de développement (AFD), ils fustigent depuis la déstabilisation du nord du Mali en 2012 les nombreux ratés des agences d’aide au développement dans cette région. Ils soumettent aussi des recommandations et propositions, qui misent en premier lieu sur une relance de l’économie rurale et sur une reconstruction des institutions régaliennes. L’occasion de mieux comprendre les mécanismes de l’aide internationale, qui consacre des parts infimes à ces secteurs, pourtant jugés cruciaux par ces spécialistes des questions de développement.
En France, un centième de l’aide publique au développement est affecté au Sahel, selon eux. Soulignons que le budget de l’aide française a baissé durant le quinquennat de François Hollande, pour s’établir à 0,37 % du revenu national brut (RNB) en 2015. C’est à peu près la moitié de l’objectif fixé par l’ONU (0,7 %). Au-delà du montant de l’aide, cependant, c’est surtout sa gestion qui interpelle Serge Michailof.
Pourquoi les États fragiles d’Afrique, au Sahel, n’en sont-ils pas les principaux bénéficiaires ? Pourquoi certains secteurs-clés ne sont-ils pas concernés, ou si peu, par l’aide au développement depuis l’intervention militaire étrangère au nord du Mali ? Autant de questions auxquelles il a accepté de répondre pour le Point Afrique.
Le Point Afrique : avec Olivier Lafourcade, vous avez préparé un document sur les risques de la déstabilisation du Sahel à l’attention des responsables politiques, mais aussi des candidats à la présidentielle, quel était l’objectif de votre démarche ?
Serge Michailof : Depuis six-sept ans, et de manière plus active depuis janvier 2013, date de l’intervention militaire étrangère au Mali, nous militons pour une réforme de l’aide française à cette région, car elle est, selon nous, la mieux armée pour répondre aux défis qui s’y posent. J’avais pour ma part pu observer l’échec lamentable de l’aide internationale en Afghanistan entre 2002 et 2014, avec un gaspillage de ressources et un sentiment d’abandon de la part de la population locale, et il s’agissait à travers cette démarche de prévenir une évolution de ce type avec le conflit parti du nord du Mali en 2012. Nous pensons que ce qui se joue au Sahel représente des risques majeurs non seulement pour l’Afrique de l’Ouest, mais aussi pour l’Europe et la France, et nous voulions essayer d’infléchir le cours des choses.
Comment votre démarche a-t-elle été accueillie par les responsables politiques français et par les candidats à la présidentielle que vous avez rencontrés ?
Au départ, nous n’avons pas vraiment été entendus dans les cabinets ministériels. Les choses ont commencé à changer à partir de l’effondrement du Mali en 2013 et de la publication de mon livre Africanistan* en 2015. Nous avons alors été auditionnés en particulier par la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, à plusieurs reprises, où on a senti une unanimité concernant nos analyses, de la gauche radicale à la droite dure. Nous avons aussi plaidé dans des foras très divers – j’ai fait plus de 50 conférences et interventions publiques sur la question. Cependant, rien n’a changé concrètement au niveau de la politique française d’aide au Sahel. Le président François Hollande a, certes, décidé d’octroyer une « facilité spéciale pour les pays en crise » dotée de 100 millions d’euros sous forme de dons, qui devait être mise à la disposition de l’Agence française de développement (AFD) cette année, en février. Mais Bercy (le ministère de l’Économie et des Finances, NDLR) en a bloqué le décaissement, alors qu’il s’agissait d’une première étape de l’aide qu’il aurait fallu engager dès 2011-2012 et non pas en 2017.
Comment vos analyses ont-elles été reçues dans les ministères, que ce soit à Bercy, au Quai d’Orsay ou au ministère de la Défense ?
On nous a renvoyés au ministère délégué du Développement où vous avez des ministres qui changent tous les 18 mois, ce qui limite la possibilité d’engager des réformes sérieuses. Par ailleurs, ce ministère est sans grand pouvoir et ne peut pas s’imposer face à Bercy. En fin de compte, vous avez des institutions françaises qui, chacune dans leur logique, continuent dans le « business as usual », comme s’il n’y avait pas le feu à la maison, alors que le Sahel est en crise. Les seuls à nous avoir vraiment pris au sérieux, ce sont, d’une part, l’Agence française de développement (AFD), et d’autre part, les militaires. Ils nous ont reçus, écoutés, invités à faire des conférences… Ils savent que la situation est critique car ils sont en première ligne.
Et comment ont réagi les candidats à la présidentielle ?
Nous avons discuté avec Alain Juppé, qui a compris l’ampleur du problème, mais il a perdu la primaire. Puis nous avons rencontré les équipes d’Emmanuel Macron, de Benoît Hamon, ainsi que des personnalités chez Les Républicains. Nos idées ont filtré auprès d’eux, tout comme elles avaient été bien accueillies à l’Assemblée nationale et au Sénat. Mais ce consensus se heurte à l’inertie ou à la mauvaise volonté des bureaucraties. Un parlementaire m’a même dit : « Il est plus facile de partir en guerre contre les djihadistes que contre Bercy ».
Selon vous, que faudrait-il mettre en œuvre en matière d’aide au développement dans les régions sahéliennes touchées par l’insécurité ?
Deux problèmes majeurs se posent. Il y a d’abord une stagnation de l’économie rurale, qui est censée occuper 80 % de la population, et qui, aujourd’hui, ne peut plus offrir suffisamment de travail et de nourriture à une population de plus en plus nombreuse. Le deuxième problème est lié à la disparition de l’État et à la montée de l’insécurité dans des zones immenses du territoire malien. Il y a une nécessité de reconstruire des appareils d’État, qu’il s’agisse de l’armée, de la gendarmerie ou du système judiciaire, et cela pose des problèmes techniques, politiques et financiers.
Vous dites qu’il faut notamment relancer l’économie rurale… Quelles sont les aides, aujourd’hui, en matière de soutien à l’agriculture au Mali, pays dont l’économie dépend fortement du secteur agricole, et où le monde paysan concentre environ 70 % de la population ?
En octobre 2015, lors de la conférence de Paris sur le Mali, les donateurs ont promis 3,4 milliards de dollars. Mais sur ce montant, seulement 3,7 % sont affectés à l’agriculture et à l’élevage, ce qui est absurde. Ce secteur est dédaigné par la plupart des donateurs internationaux alors que le potentiel d’amélioration agricole au Sahel est considérable, en particulier par la restauration des sols et la généralisation de l’agro-écologie.
Concernant l’aide publique au développement française, qui se situe entre 8 et 10 milliards d’euros par an, entre 80 à 100 millions d’euros de dons sont affectés à des projets concrets au Sahel, dans le cadre de l’aide bilatérale. Et sur ce montant, moins d’une trentaine de millions d’euros sont destinés à l’aide au développement rural, ce qui représente moins de trois pour mille de l’aide française. C’est à pleurer de bêtise !
Le rapport de 2008 de la Banque mondiale avait placé l’agriculture au cœur des enjeux de développement, une première depuis 25 ans… Ce rapport a-t-il eu des répercussions dans la prise en compte de l’économie rurale ?
C’était un bon rapport, qui mettait l’accent sur le fait que l’aide internationale ne se préoccupait plus du secteur agricole depuis, en gros, le départ de Robert McNamara (ancien président de la Banque mondiale de 1968 à 1981, NDLR). Dans les années 70, plus du tiers de l’aide de la Banque mondiale allait vers le développement du petit paysannat, tandis qu’aujourd’hui, la part de l’aide affectée à ce secteur tourne autour de 6 à 7 %. Il y avait à cette période une véritable expertise sur le développement rural africain. Mais aujourd’hui, vous ne trouvez plus cette expertise, si ce n’est à l’AFD, au Département du développement international britannique (DFID) et à l’Ifad (Fonds international de développement agricole de l’ONU).
C’est donc là où il y a le plus de ressources qu’on manque d’expertise. Je rentre d’une mission à Washington avec la Fondation pour les études et la recherche sur le développement international (Ferdi) et l’université de Berkeley en Californie, où nous avons plaidé pour la mobilisation de ressources destinées au développement rural, au planning familial et au renforcement des institutions régaliennes au Sahel. Nous avons rencontré notamment des experts et des responsables de la Banque mondiale.
Il ne s’agit évidemment pas du discours officiel, mais en tête à tête, nombre de mes interlocuteurs ou anciens amis m’ont avoué s’arracher les cheveux pour trouver l’expertise permettant de gérer les sommes considérables dont ils disposent. Ils manquent de compétences en matière agricole, sur les questions éducatives et démographiques, sans parler des sujets institutionnels. La Banque mondiale, tout comme l’Union européenne d’ailleurs, considère que les tâches de reconstruction des armées, des gendarmeries et de l’administration territoriale au Sahel ne relèvent pas de leur mandat. Mais alors qui va s’occuper de ces questions ? Seulement 0,1 % des 3,4 milliards d’euros promis au Mali en 2015 sont affectés à la réhabilitation de la justice malienne.
S’agissant du renforcement institutionnel au Sahel, l’Union européenne et l’Allemagne, notamment, interviennent dans la formation des forces de sécurité maliennes… Quels sont leurs besoins ?
Au Mali en particulier, les lacunes en matière de respect des populations et de l’État de droit sont dramatiques… Les services régaliens se comportent trop souvent en prédateurs et en racketteurs et il est bien difficile dans ces conditions d’espérer compter sur le soutien des populations. La formation des personnels et la fourniture d’équipements au Mali et dans les pays voisins, certes importants, sont toutefois insuffisantes pour reconstruire l’armée. Il faut selon nous réorganiser et restructurer la plupart des institutions régaliennes en réinstaurant les principes de mérite et de performance, mais aussi mettre fin au clientélisme et au népotisme. Ce n’est envisageable que si la communauté internationale accepte de financer les coûts de telles restructurations.
Quel peut être concrètement le rôle de la France dans d’éventuelles réformes institutionnelles au Mali ?
Au plan politique, il faudrait qu’il y ait un dialogue assez ferme au plus haut niveau afin de mettre les autorités face à leurs responsabilités. Si elles veulent que la France les aide, il y a des réformes à mettre en place pour reconstruire un appareil d’État qui fonctionne. Si ces réformes ne sont pas engagées, l’armée française va s’enliser. S’il y a manifestement un refus des réformes, comme ce fut le cas avec le régime d’Ahmid Karzai en Afghanistan, nous n’aurons pas d’autre choix réaliste que de laisser les autorités maliennes se débrouiller avec les djihadistes.
Au plan technique, il est possible d’associer l’expertise française, que ce soit en matière de développement rural ou de reconstruction d’institutions, lesquelles ont initialement été construites selon le modèle français.
Vous prônez donc plus d’ingérence, plus d’interventionnisme de la part de la France ?
À quoi bon rester au Mali si les autorités ne réforment pas certaines de leurs institutions et de leurs pratiques ? On va se battre à la place des Maliens, et s’embourber au Sahel de la même façon que les Américains et les troupes occidentales se sont enlisées en Afghanistan ? On va essayer de se substituer à une administration défaillante en essayant de mettre en place une assistance technique à droite à gauche ? Ce n’est pas comme ça qu’on peut s’en sortir.
Vous proposiez en 2013 la création d’un fonds d’aide au Sahel, avec un premier versement de la France de 200 millions d’euros, qui produirait un effet de levier pour mobiliser jusqu’à un milliard d’euros par an… Or, la France peine déjà à atteindre l’objectif de consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’aide au développement. Où piocher la mise de départ de 200 millions d’euros ?
L’effort budgétaire français consacré à l’aide est de l’ordre de 2,8 milliards d’euros. On peut récupérer ces 200 millions en révisant les priorités d’affectation de ces ressources. Par exemple, la France transfère environ 430 millions d’euros au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C’est important de contribuer à ce Fonds, mais il est aberrant d’y verser deux fois plus de subventions que ce qu’on affecte sur 16 pays tous secteurs confondus.
À quoi faites-vous référence ?
L’aide bilatérale de la France en matière de dons s’établit à environ 200 millions d’euros par an, et cette enveloppe doit être répartie entre 16 pays, dont beaucoup sont situés hors d’Afrique.
Pourquoi l’Afrique subsaharienne, et en particulier les États dits « fragiles » du Sahel ne sont-ils pas les premiers récipiendaires de l’aide française ?
Pour des raisons politiques et statistiques, on choisit des instruments et des canaux de distribution de notre aide qui ne favorisent pas ces régions. Notre aide est tout d’abord principalement distribuée par le canal des institutions multilatérales et onusiennes qui bénéficient d’environ 1,7 milliard sur les 2,8 milliards de notre effort budgétaire. Pour le reste qui correspond à notre aide bilatérale, depuis 20 ans, la part des dons s’est considérablement rétrécie et se chiffre aujourd’hui à 200 millions d’euros. La part des prêts a au contraire fortement augmenté.
Pourquoi les prêts ont-ils été favorisés comme instrument d’aide ?
Essentiellement pour gonfler nos statistiques. Car quand on donne un euro à l’AFD pour bonifier ses prêts et les intégrer dans le calcul de notre aide au développement, elle « fabrique » 12 euros d’aide publique au développement. La France est le seul pays au monde qui ait conduit sa politique d’aide à un tel niveau d’absurdité. Le problème, c’est qu’avec 200 millions de dons par an pour 16 pays bénéficiaires, on ne peut faire que du saupoudrage. Et avec des prêts on ne vient plus en aide aux pays pauvres du Sahel, et vous ne pouvez pas financer du développement rural car cela ne va pas générer de recettes budgétaires pour rembourser le prêt. Donc ce choix stratégique du prêt par rapport au don fait que vous orientez votre aide vers des pays intermédiaires, et les pays émergents. Au final, notre appui effectif au Sahel sous forme de dons représente un centième de notre aide publique au développement. On maquille un peu ces chiffres en y ajoutant le coût de l’assistance technique et diverses autres dépenses. Mais la réalité est là : l’AFD ne dispose pas des ressources nécessaires en matière de dons pour travailler avec les pays de cette région, alors que, de tous les donateurs, c’est pourtant elle qui dispose de la meilleure expertise.
En quoi l’expertise française concernant le développement rural ou la reconstruction des institutions régaliennes vous paraît-elle meilleure ?
Le stock d’expertise française est colossal. Nous avons des instituts de recherche qui travaillent depuis plus d’un demi-siècle sur le Sahel, à l’instar de l’Institut de recherche et développement (IRD) ou du Centre international de recherche agronomique pour le développement (Cirad). Ils ont leurs réseaux de correspondants locaux, des centres d’expérimentation. Nous avons aussi Expertise France et l’AFD, qui a gardé une forte expertise en matière de développement rural. Nous pouvons enfin compter sur les ONG de développement. Si vous prenez les dix ONG françaises les plus importantes, vous avez 1 600 ingénieurs et techniciens disponibles. Je ne vois pas dans quel autre organisme d’aide vous allez trouver ces ressources-là.
PROPOS RECUEILLIS PAR AGNÈS FAIVRE
Le Point Afrique
1270 Vues



